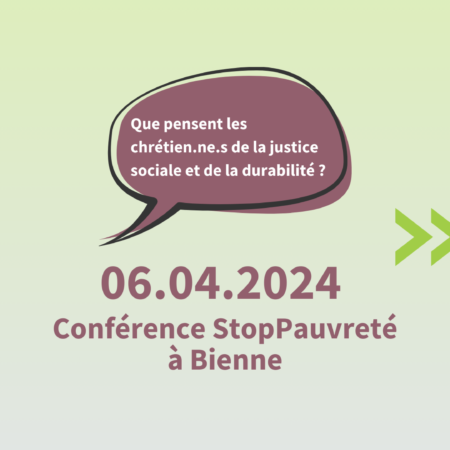Se former à la HET-PRO
Prochaines conférences et évènements
WORKING LUNCH
RÉFLÉCHIR À LA PRATIQUE : OÙ SONT LES FEMMES ?
Certificats en Théologie et Société et cursus Découverte
Actualités de la HET-PRO
RENCONTRE DE JEUNESSE à BULLE
Conférence FOI, CLIMAT ET ESPÉRANCE
La HET-PRO accueille une micro ferme sur son terrain
Notre vision
Unis par l’Évangile, formons la personne, construisons l’Église, servons la société !
Notre mission
Offrir des formations en théologie conjuguant spiritualité vivante, excellence académique, dynamique missionnelle et compétences pratiques.
Nos valeurs
- Fidélité à la Parole de Dieu
- Unité dans la diversité
- Excellence et humanité
- Accueil et convivialité
- Héritage et innovation